Cette rubrique propose des informations sur ce réseau nommé Alliance sans frontières pour le partenariat de soin avec le patient et ses équipes membres
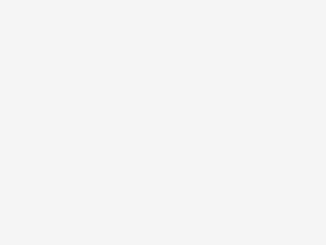
Cette rubrique propose des informations sur ce réseau nommé Alliance sans frontières pour le partenariat de soin avec le patient et ses équipes membres
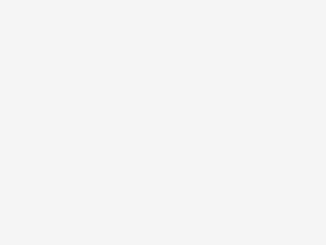
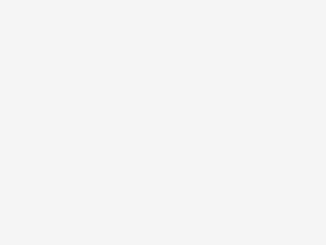
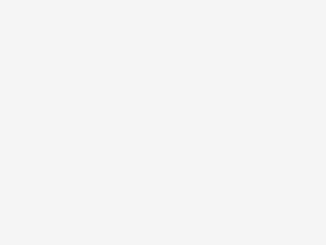
Depuis le lancement en 2018 de la première formation à l’Art du soin en partenariat avec le patient, une formation primée dès sa première année […]
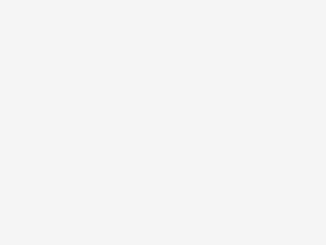
L’association ISPE, portée par une équipe membre de l’Alliance sans frontière pour le partenariat de soin avec le patient, l’équipe ECSTRRA organise les 21, 22, […]
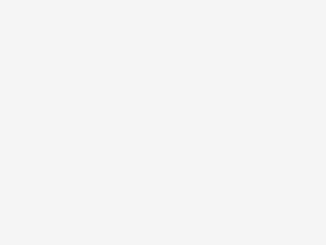
Le Centre national de ressources et de résilience (Cn2r) a pour objectif de favoriser la résilience des personnes vivant ou ayant vécu l’épreuve du traumatisme […]
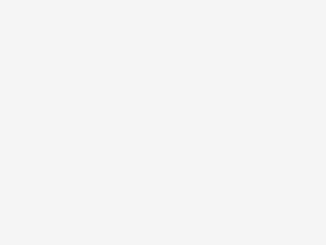
Alors que ce prépare le colloque organisé tous les deux ans de la Société Française de Pharmacie Clinique (SFPC) prévu pour se tenir en mars […]
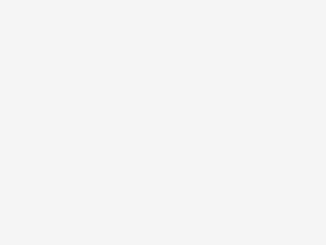
La recherche Européenne INTERREG APPS pour Approche Patient Partenaire de Soins a interrogé par le biais de l »équipe française de Nancy, membre de l’alliance sans […]
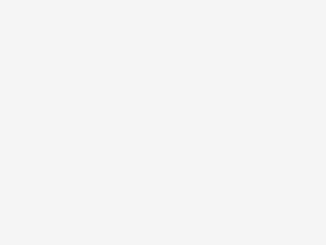
Alors que depuis une dizaine d’année les étudiants en orthophonie participent au cours en Sciences de la Santé, les enseignements sur la collaboration interprofessionnelle en […]
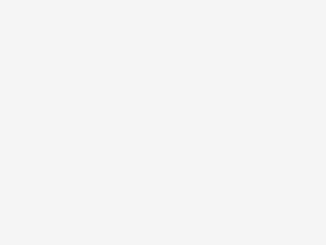
APPEL À CONTRIBUTION DE PUBLICATION DU SECOND NUMERO SEMESTRIEL 2021 DE LA REVUE INTERNATIONALE : LE PARTENARIAT DE SOIN AVEC LE PATIENT : ANALYSES En 2020 a […]
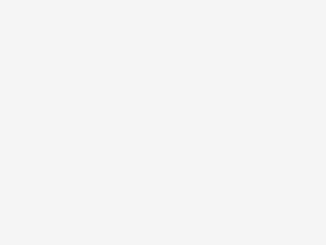
APPEL À COMMUNICATION en prévision du 2ème COLLOQUE SUR LA PLACE DU PATIENTAU 21 ème SIÈCLE, À L’ÈRE DU PARTENARIAT Dans le prolongement d’un axe de recherche juridique sur « la […]
Copyright © 2024 | Thème WordPress par MH Themes